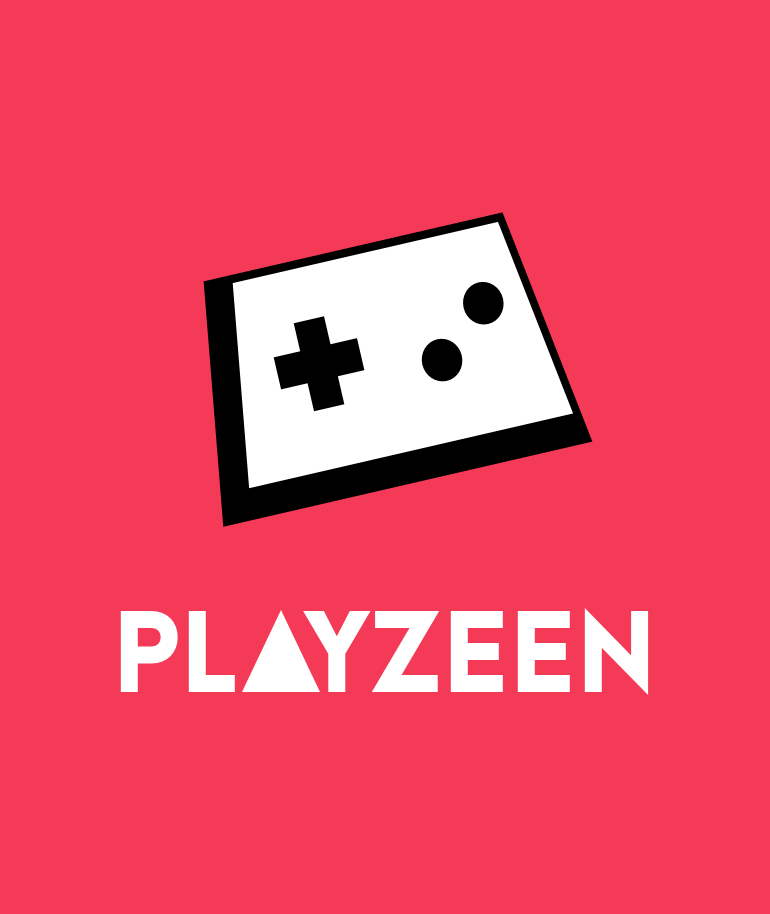Il est des histoires avec lesquelles la fiction aurait presque peine à rivaliser tant celles-ci sont hors-normes. Il en va ainsi de la vie du soldat Onoda qui, refusant de croire à la capitulation du Japon, passa près de trois décennies à vivre caché au cœur d’une ile des Philippines, poursuivant le combat envers et contre tout. Dans « Onoda, 10 000 nuits dans la jungle » (dont la critique est à retrouver ici), le réalisateur Arthur Harari retrace l’odyssée de ce combattant jusqu’au-boutiste, livrant le saisissant portrait d’un homme pris dans la toile de ses propres chimères. Rencontre.
Comment avez-vous découvert l’histoire d’Hiro Onoda ?
Je désirais réaliser un film d’aventures depuis plusieurs années. Sachant que j’étais à la recherche d’un sujet à même de correspondre avec ce projet, mon père m’a un soir parlé d’Onoda. Initialement, je n’avais pas particulièrement d’attrait pour le Japon ni pour l’Asie, à l’exception des Philippines curieusement. C’est un pays pour lequel j’éprouvais une certaine
attirance, bien que paradoxalement, je ne m’y sois toujours pas rendu à l’heure actuelle.
A mesure que je me documentais sur Onoda, j’ai toutefois été progressivement happé par le récit de cette guérilla insensée.
Qu’est-ce qui vous a séduit dans le récit d’Onoda et des « soldats japonais restants » ?
J’ai trouvé qu’il y avait là une absurdité aux dimensions quasi-mythologique. Raconter cette
histoire s’est imposé à mes yeux comme une sorte d’évidence.
Pourquoi ce choix de tourner le film au Cambodge plutôt qu’aux Philippines, là où Onoda a vécu toutes ces années en maquisard ?
Au départ, je désirais effectivement tourner sur l’ile même où Onoda s’était terré, mais j’ai vite réalisé que cela posait de nombreux problèmes sur le plan logistique. Il faut savoir que l’ile de Lubang est assez excentrée du reste de l’archipel et donc difficile d’accès, même pour les gens du cru.
Au-delà du cas de Lubang, il fallait également tenir compte de la situation politique actuelle du pays. Une partie du territoire est toujours en proie à une insurrection d’ordre djihadiste. A cela s’ajoute la politique ultra-violente menée par le gouvernement de Rodrigo Duterte. J’avoue que je ne trouvais pas ça très rassurant (Rires).
Point de vue production, il s’est avéré nettement plus facile de collaborer avec le Cambodge que les Philippines. C’était assez miraculeux la facilité avec laquelle tout s’est mis en place une fois le Cambodge attaché au projet.
C’est un projet assez ambitieux, d’autant plus qu’il s’agit seulement de votre deuxième long-métrage. Outre le fait de tourner dans un autre pays avec un casting exclusivement étranger, on songe à la durée du film et par extension du récit qui s’étale sur près de trois décennies. Avez-vous rencontré des difficultés au niveau du financement ?
Comme il n’y avait pas eu de projet similaire duquel s’inspirer en termes de production dans le cinéma français, il a fallu se montrer inventif et expérimenter tout azimut, que ce soit au niveau de la production, de l’écriture, du casting, des repérages, etc… La mise en chantier de ce projet a été longue et complexe mais j’ai pu compter sur mon producteur Nicolas
Anthomé (de la société bathysphère, ndlr). Je n’ai pas eu de difficulté à le convaincre dans la mesure où nous étions à peu près sur la même longueur d’ondes quant à la direction à donner au film. Je n’ai jamais éprouvé le sentiment d’être seul à la barre durant les différentes étapes de ce projet.
Comment s’est déroulé le tournage ?
La pré-production et la production se sont déroulées entre décembre 2018 et mars 2019. Le tournage en lui-même a duré environ trois mois, précédé de plusieurs semaines de repérages. Celui-ci s’est passé sans trop d’encombres, nous n’avons pas rencontré de difficultés majeures. Il n’y a eu ni catastrophes ni tension au sein de l’équipe, nous n’avons pas eu nous battre contre les éléments ou l’adversité comme cela a pu être le cas lors du tournage de certains films se déroulant dans la jungle, à l’image d’Apocalypse Now ou de Fitzcarraldo.
Toujours est-il qu’à notre échelle, c’était une aventure énorme vu qu’aucun membre de l’équipe n’avait fait quelque chose de comparable avant. Je tiens à ce titre à saluer le producteur exécutif franco-cambodgien Davy Chou, qui est également un réalisateur et un ami. Il a porté le projet sur ses épaules tout du long, au prix de sueurs froides jusqu’au dernier jour de tournage. De mon côté, cette expérience s’est avérée être un bonheur total.
Le film est presque entièrement tourné en japonais, une langue qui n’est pas la vôtre et que vous ne parlez pas. Cela a-t-il eu une incidence sur votre manière de travailler ?
Oui, de fait. Je pense qu’en un sens, ça a libéré mon rapport à la parole et à ce qu’on a l’habitude de considérer comme la justesse en matière de jeu d’acteur. Compte tenu du décalage occasionné par la barrière de la langue entre moi et les comédiens, j’ai dû chercher cette justesse ailleurs que dans la simple parole. Il m’a fallu apprendre à surmonter la barrière linguistique, les barrières culturelles et à faire confiance aux acteurs, tout en veillant à garder une certaine exigence.
Il y a eu comme un abandon de ma part dans la façon de les diriger. Je devais nécessairement passer par ce processus pour mieux comprendre le personnage. Cela m’a amené par ricochet à une réflexion sur l’altérité. Je suis intimement convaincu que je n’aurais pas réalisé le même film si j’étais japonais.
Indépendamment de la question linguistique, avez-vous constaté une différence entre les acteurs japonais et leurs homologues français dans leur manière de travailler ?
Mon avis ne se base que sur ce que j’ai pu observer durant le tournage de ce film, je ne peux donc affirmer qu’il s’agit d’une généralité mais dans le cas présent, j’ai constaté qu’ils faisaient preuve un grand sens de la préparation. Une obsession de la préparation presque.
Il y a par exemple une scène, assez courte du reste, dans laquelle on voit un des soldats débiter un gros fruit tropical à la machette. Afin de coller au plus près du personnage, qui est supposé être rompu à la tâche, son interprète a tenu à ce qu’un des assistants cambodgiens lui montre comment s’y prendre afin qu’il puisse s’exercer en amont. Il a pas mal galéré
d’ailleurs (rires) Ça lui a demandé plusieurs heures de pratique pour arriver au résultat escompté. Rien n’était pris à la légère. Je ne suis pas en train de dire que c’est le cas pour les acteurs français mais j’ai tout de même eu l’impression qu’il y avait de la part des acteurs japonais un investissement plus poussé. Cela peut sembler paradoxal, mais plus ils avaient une idée
précise du personnage et de la nature de la scène, plus ils se montraient réceptifs et ouverts à l’improvisation.
On aurait pu croire que le fait d’être dirigé par une personne ne parlant leur langue et étranger à leur culture constituerait éventuellement un frein mais j’ai trouvé les acteurs avec qui j’ai collaboré sur ce film vraiment incroyables, à l’écoute et investis dans leur rôle.
Pour en revenir à des considérations plus prosaïques, ils sont généralement payés beaucoup
moins que les acteurs français. Il en résulte chez eux une très grande humilité, proportionnelle au don de soi qu’ils démontrent sur le plateau. Leur statut de « vedettes » ne change en rien leur manière d’être et de travailler. Je n’ai ainsi jamais eu à composer avec d’éventuelles exigences de leur part au cours du tournage.
Aviez-vous des œuvres, cinématographiques ou autres, en tête lors de la conception et de la réalisation du film ?
Beaucoup oui. Naturellement, j’ai d’abord puisé mon inspiration dans le cinéma japonais. Les grands maitres, Mizoguchi, Akira Kurosawa mais aussi dans un style radicalement différent, Koji Wakamatsu.
En termes de jeu et de direction d’acteurs, j’ai été très marqué par les films de Kiyoshi Kurosawa, un réalisateur que j’adore. On retrouve d’ailleurs dans le films plusieurs acteurs ayant tourné avec lui : Kai Inokawi qui, alors jeune adolescent, avait joué dans Tokyo Sonata, de même que Kanji Tsuda, qui interprète Onoda vieux.
Je citerais en outre Feu dans la plaine de Kon Ichikawa (sorti en 1959, ndlr), un film cauchemardesque se déroulant également sur une ile des Philippines durant les derniers soubresauts de la Guerre du Pacifique qui m’avait laissé une vive impression. Dans un registre un peu différent, il y a ce film assez génial de Kinji Fukasaku, Sous les
drapeaux, l’enfer, (sorti en 1972, ndlr). A l’instar de mon film, le récit fait des va-et-vient entre le passé, en l’occurrence la guerre, et le présent. Thématiquement, ce sont deux œuvres qui se rejoignent sur le questionnement autour de la notion d’héroïsme. Ce long- métrage est en revanche très éloigné du mien sur le plan stylistique, d’une virtuosité
baroque proche de celle de Scorsese.
Les grands classiques du cinéma américain constituent une autre source d’influence notable : je pense aux films de John Ford, Raoul Walsh, Samuel Fuller, Monte Hellman, des réalisateurs qui ont en commun de s’être illustré dans le film de guerre ainsi que le western.
Pour ce qui est du reste de l’Asie, j’évoquerais de plus le cinéma taiwanais, Hou Hsia-hsien notamment.
Etant un gros lecteur de mangas, surtout de mangas d’auteurs et de mangas réalistes, je mentionnerais par ailleurs plusieurs œuvres de Shigeru Mizuki, notamment son récit autobiographique en trois tomes (disponibles aux Editions Cornelius, ndlr), un témoignage qui permet de mieux comprendre ce que signifie être un individu japonais face à la guerre tout en s’éloignant de cette image d’Epinal de l’héroïsme sacrificiel du soldat japonais. Il a d’autre part un rapport à la nature, à la jungle qu’il transpose d’une façon absolument sublime dans ses dessins.
La sortie du film dans les salles nippones est prévue pour le mois d’octobre. On sait que l’évocation de cette période reste encore aujourd’hui un sujet sensible, comme en témoignent les controverses entre le Japon et les anciens pays occupés, à l’instar de la Chine ou la Corée, autour de la question des « femmes de réconfort » ou la reconnaissance des crimes commis par l’armée impériale. Avez-vous déjà eu des retours quant à l’accueil que le public japonais pourrait réserver au film ?
C’était en effet source d’interrogations pour moi avant la présentation du film, mais les personnes ayant assisté à la projection cannoise, journalistes ou simples spectateurs, japonais ou non, l’ont beaucoup apprécié. En ce qui concerne les japonais présents à cette avant-première, ceux-ci m’ont confié avoir été très touché par le film, tout en comprenant que mon but n’était en aucun cas de réaliser une hagiographie d’Onoda. Je pense d’ailleurs que le fait d’aborder des aspects moins reluisants du personnage pour mieux en comprendre la complexité peut en partie expliquer cet accueil positif. Je suis pour ma part assez
impatient de voir comment le film sera plus largement reçu une fois sorti au Japon.
De son vivant, Onoda était une figure révérée au sein des milieux nationalistes. Il faisait d’ailleurs parti d’une organisation de tendance militariste et révisionniste, prônant par exemple l’abrogation de certains articles de la Constitution élaborée au lendemain de la guerre. Ne craignez-vous pas une récupération du film à des fins politiques ?
Je ne pouvais évidemment occulter cette possibilité. J’estime pourtant qu’il n’y aurait pas réellement d’intérêt pour eux à faire cela. Onoda étant aujourd’hui un personnage trop controversé aux yeux de l’opinion japonaise, il ne peut désormais plus être envisagé uniquement comme un héros. Je ne vois pas trop comment le film pourrait servir d’outil de propagande mais peut-être suis-je très naïf (Rires). La question reste ouverte mais ce serait une vraie surprise si tel était le cas.
Merci à Arthur Harari et Karine Durance