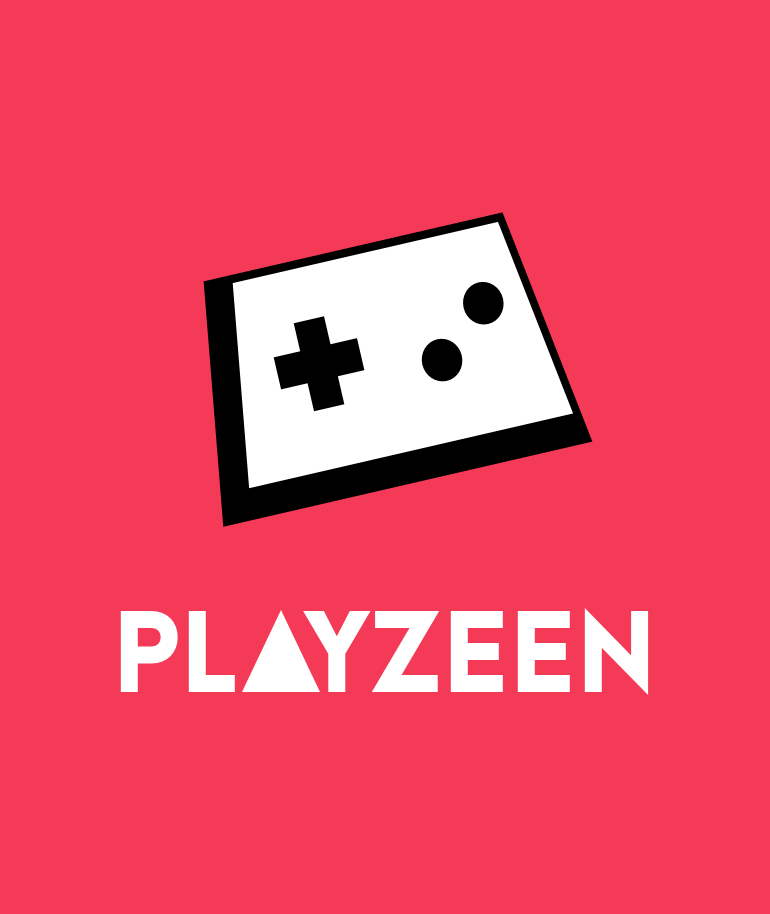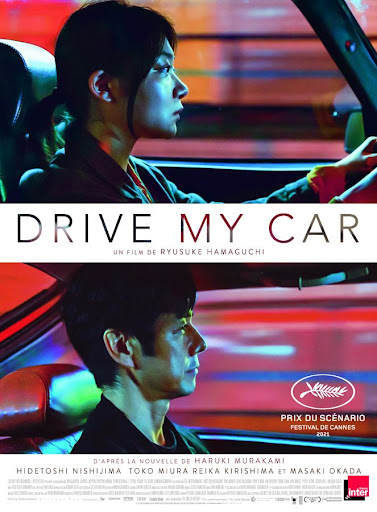
Trois ans après son envoûtant Asako I & II, et en ayant entre temps réalisé le film Wheel of Fortune and Fantasy n’ayant pas trouvé de chemin vers les salles françaises, Ryūsuke Hamaguchi était de retour au festival de Cannes 2021 avec son Drive my car.
Adaptation de la nouvelle du même nom, le film raconte l’histoire d’un metteur en scène et acteur de théâtre de renom, Yusuke Kafuku, qui voit sa vie s’effondrer petit à petit lorsqu’il découvre que sa femme, célèbre scénariste, le trompe avec un jeune acteur puis qu’elle décède tragiquement. Plusieurs années après ce traumatisme qui l’a éloigné des planches, il se laisse convaincre de monter la pièce Oncle Vania de Tchekov à l’occasion d’un festival. On lui assigne alors une chauffeur avec qui les échanges discrets et timide vont devenir de plus en plus sincères et intimes. Elle aussi est enlisée dans un deuil la rongeant, et c’est dans leurs solitudes respectives que les deux personnages vont se reconnaître et se lier.
Et c’est là que Hamaguchi trouve sa force : à travers la pudeur des relations, retranscrites par sa caméra effacée, il parvient à sublimer ces moments du quotidien, comme un trajet en voiture, ou un repas chez un ami. Hamaguchi modèle ainsi son film autour de sentiments violents – le deuil, la colère, la culpabilité – et de personnages qui souffrent, mais parvient à le faire tout en délicatesse, délaissant les fulgurances dramatique pour leur préférer une mise en scène subtile et suggestive. Le réalisateur est économe de mot, laissant les fantômes du passé venir combler les silences.
La mise en abîme théâtrale est elle aussi plutôt bien réussi, notamment à travers ces – parfois un peu trop – longues séquences de lecture de texte de la part des comédiens, où est démontrée toute l’exigence de Kafuku et sa manière de façonner la pièce à son image, selon ses émotions et non celles de ses acteurs. Ce sont alors des simples nuances d’intonations de voix qui prennent toute leur importance, de la même manière que c’est à travers un enregistrement de sa voix que Kafuku maintient un lien avec sa défunte femme. Cette thématique du langage est également bien explorée, de par le fait que les différents comédiens ne parlent pas tous la même langue, et répètent ainsi parfois sans se comprendre les uns les autres.
Et Hamaguchi pousse ce jeu de silences et paroles encore plus loin, lorsqu’il place au milieu de ce monde une actrice muette, jouant l’un des rôles principaux en langage des signes. A la fin lorsqu’un concours de circonstances oblige Kafuku à jouer lui-même dans la pièce, il se retrouve alors à échanger sur scène avec cette actrice, donnant un résultat assez sublime.
Cependant, ce joli manège dure tout de même 3 heures, et semble parfois se résumer à tourner en rond, prenant tant son temps qu’il peut faire décrocher plus d’un spectateur. Le rythme est celui d’une ballade, lente et douce, qui peut parfois laisser notre cerveau vagabonder sur d’autres chemins, enlevant malheureusement ainsi du poids aux enjeux portés par les personnages, pourtant tous très bien interprétés.
Le film s’est tout de même vu gratifié d’un prix du scénario à Cannes, laissant Hamaguchi comme un bon prétendant à recevoir des récompenses de plus en plus conséquentes à l’avenir. Il est d’ailleurs appréciable de voir ce film à l’affiche peu de temps après son passage en festival (il sort ce jour, le 18 août). En effet certaines des précédentes œuvres du nippon sont parfois sorties en France plusieurs années après leur fin de réalisation ; on pense notamment comme pour son ambitieux Senses en 5 parties qui a été diffusé par chez nous 3 ans après sa présentation au Japon.