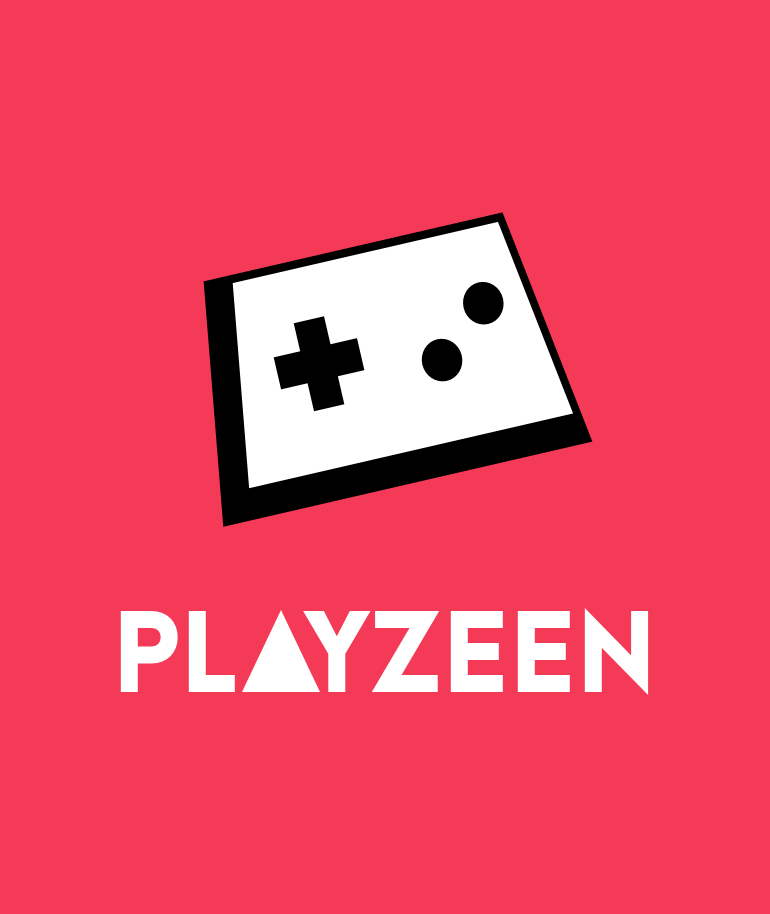NB : On se concentre uniquement ici sur les 3 premiers volets d’Il était une fois en Chine : ils sont en effets les seuls à réunir Tsui Hark et Jet Li, et il convient donc de les considérer d’un bloc.
Si le nom « Il était une fois en Chine » n’a peut-être pas été choisi par Tsui Hark, il faut reconnaître que ce titre – international, donc – ne manque pas pour autant de pertinence. Et pour cause, ce rapprochement avec la trilogie de Sergio Leone permet d’attirer l’attention sur ce qui fait l’intérêt de la saga hong-kongaise, à savoir la densité de son propos, qui mêle petite et grande histoire, destins individuels et trajectoire nationale, dans le même élan. Entre la fiction et la réalité, les lignes de fuite sont spongieuses, et le fait que le personnage central, Wong Fei-hung, soit une figure historique dont les exploits confinent au conte par le truchement des innombrables fictions qui lui ont été consacrées ne fait rien pour arranger l’affaire… Mais c’est tant mieux, car Tsui Hark est le king du chaos, le roi du flou, le pimp du bordel ; c’est lorsque les situations s’échappent qu’il devient, plus que jamais, l’homme de la situation, et Il Etait une fois en Chine parvient justement à atteindre un point d’équilibre assez formidable entre la puissance créative de savant fou du réalisateur et son sens de la technique. C’est sur la brèche que Tsui Hark est le meilleur, et c’est tant mieux, puisqu’Il était une fois en Chine est surtout une histoire de brèches.
Le contexte même des deux premiers films est celui d’une Chine morcelée, fragilisée par l’incroyable bordel politique qui y règne en cette fin de XIXe siècle, une Chine pseudo-dirigée par le dernier empereur mandchou, où squattent allègrement les Japonais, les Américains et les Brittons, pas forcément toujours d’accord sur leurs positions respectives dans la chaîne alimentaire. C’est une Chine où chacun se sent chez soi, sauf les Chinois (essayez de la dire vite, vous verrez c’est pas évident). Sur ce terrain forcément miné, la population locale s’organise entre les autorités officielles corrompues ou bridées, les terroristes révolutionnaires, les collabos, et les miliciens tentant d’empêcher la situation de basculer une bonne fois pour toutes dans la plus extrêmes des tyrannies. On y est combattant ou victime, mais la neutralité n’est pas une option : chaque Chinois est une étincelle susceptible de foutre le feu à la poudrière, et nombreux sont ceux qui, comme NTM en Seine St-Denis, se demandent ce qu’ils attendent pour foutre le feu.
Et là, au milieu de ce merdier, qui trouve-t-on ? Jet Li, prolétaire impérial, guerrier intellectuel, pacifiste létal : le mec peinard auquel on sent pourtant qu’il ne vaut mieux pas se frotter, sous peine d’y laisser ses plumes, ses dents, et sa dignité. C’est autour de son personnage, Wong Fei-hung, que s’articulent les différentes intrigues de la saga. Médecin, maître de kung-fu et philosophe malgré lui, il est surtout citoyen chinois, et se retrouve donc plus ou moins malgré lui embringué dans le destin de son pays ; jamais belliqueux mais toujours insoumis, il ne saurait tolérer ni l’injustice, ni la tyrannie, surtout pas si celles-ci décident de s’attaquer à ses potes ou à ses pitoyables élèves. Toujours bon et mesuré, strictement invincible quelle que soit la situation, Wong Fei-hung est en réalité un personnage dénué de réelle densité, qu’on suit surtout avec plaisir pour son rôle de catalyseur narratif, et… parce qu’il est joué par Jet Li. N’ayons pas peur des mots : non seulement Jet Li aurait du charisme même s’il jouait le rôle d’une huître, mais il parviendrait également à casser la gueule à quiconque tente de lui piquer sa perle.
Tout au long d’Il était une fois en Chine, sa seule faille restera sa « tante » Yee, en réalité une amie de la famille avec laquelle il n’a aucun lien de sang mais dont la tradition lui interdit plus ou moins de se rapprocher sentimentalement. Yee, souvent insupportable pour le spectateur, sert néanmoins dans l’intrigue à nuancer l’anti-occidentalisme qui sous-tend de manière pratiquement intrinsèque tous les films chinois traitant de cette période historique. Celle-ci revient en effet des Etats-Unis où elle a été faire ses études, et contribue à présenter l’Occident non plus uniquement comme un synonyme de domination et de corruption, mais comme une composante potentielle de la modernisation (avec l’arrivée par exemple d’un des premiers appareils photo dans le 3e volet) et de l’évolution des mœurs vers leur dé-rigidisation : si Fei-hung peut se taper sa tante en toute liberté, c’est parce que les temps changent. Il était une fois en Chine est, pour sa plus grande partie, le récit de ce basculement chaotique et mitigé, duquel ressort à la fois du bon et du mauvais, vécu à l’échelle d’une nation mais aussi au petit niveau de notre héros, gentiment réac par peur de l’inconnu et par attachement à ses repères, mais pas complètement fermé à la nouveauté si elle lui est introduite par une jolie fille.
Tsui Hark, on le sait, est un fou, et c’est pour ça qu’on l’aime. En ce sens, cette trilogie initiale est sans nul doute l’un de ses grands sommets : dans Il était une fois en Chine, tout est permis, de la scène d’ouverture du premier volet où Jet Li virevolte sur des cordages pour le seul plaisir de la caméra au dernier grand combat du film, où il combat son adversaire, dans une lutte aérienne aussi magnifique qu’invraisemblable, sur des échelles. Tout au long des trois films, chaque combat est un monument de gloire susceptible de servir de référence absolue dans les annales pourtant déjà bien riches du film de kung-fu, et les amateurs du genre se régaleront tout particulièrement devant le second volet, qui voit s’opposer Jet Li et Donnie Yen sur une chorégraphie de Yuen Woo-ping. Jet Li, Donnie Yen, Yuen Woo-ping, Tsui Hark : si vous êtes capable d’imaginer un meilleur quatuor, vous avez tout simplement tort. Visuellement, la trilogie est d’un avant-gardisme tellement incroyable qu’aujourd’hui encore on a du mal à lui trouver un équivalent, tant et si bien qu’il est facile de se demander (comme souvent avec ce cher Tsui) s’il fait preuve de bon ou de mauvais goût : fish-eye, plans obliques, angles incongrus, jeux de lumières, le maître n’écoute plus que son cœur, cherchant dans le décalage de l’image une échappatoire à la tragique réalité historique de son récit, qui confinera même à une certaine forme de surréalisme baroque dans Il était une fois en Chine III, où les combats de dragons, dont l’agressivité de la gueule contraste avec la fragilité du corps, nous transportent dans une dimension nouvelle.
C’est bien simple : que vous soyez fan de cinéma hong-kongais, de film de kung-fu, de Tsui Hark, de Jet Li ou tout simplement cinéphile, Il était une fois en Chine (au moins le premier) est un must absolu, une pierre blanche dans l’histoire du cinéma, à la fois incontournable par sa réputation et sa qualité et unique par ses singularités. Le premier film de la saga à lui seul est un chef d’œuvre de densité, de poésie, de kung-fu et d’amour patriotique réel qui accomplit le petit miracle d’harmoniser toutes ses sensibilités sans les compartimenter, en prouvant que l’histoire d’un pays est celle de chacun de ses individus, et que l’histoire personnelle des individus est intimement liée à celle du monde dans lequel ils évoluent. Contraint par les nécessités du réalisme contextuel auquel il s’attaque, Tsui Hark ne fait que briller davantage par son inventivité et son romantisme dans cette épopée qui parvient à trouver l’épique ailleurs que dans l’anéantissement de l’humain. Car si Tsui Hark est si grand, c’est avant tout parce qu’il est resté faillible, et il n’y a rien de plus beau qu’un artiste sur la brèche.