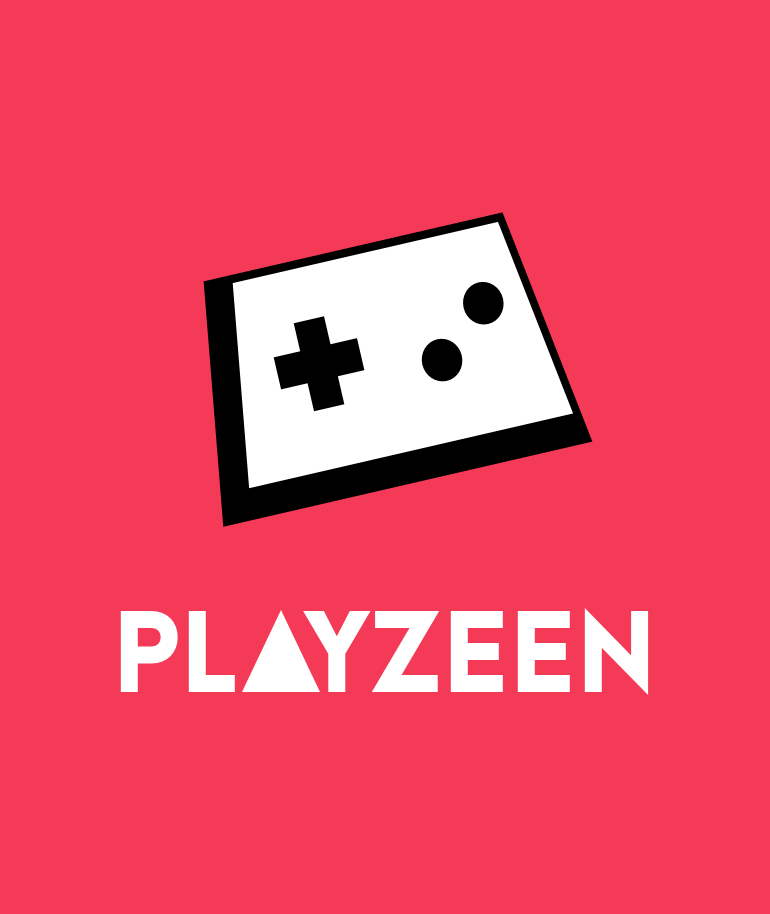C’est pour la sortie de son film coup de point The Raid (disponible à partir d’aujourd’hui), que nous avons vu avec nos copains de Vodkaster, le réalisateur Gareth Evans.
L’occasion pour nous de voir comme il a construit son film qui s’annonce comme un des films chocs de l’année.
Pour tout ceux qui en doute encore, notre critique est disponible ici
Pourquoi avez-vous choisi d’ouvrir le film sur un plan du personnage principal en train de prier ?
L’idée était de montrer l’Islam de deux manières différentes. D’abord, la scène a une fonction narrative : elle sert à montrer Iko en train de se préparer physiquement, spirituellement et mentalement. On le voit s’entraîner, prier, puis dire au revoir à sa femme, et il s’agit de trois manières différentes pour lui de trouver la force qui lui sera nécessaire pour accomplir ce qu’il a à faire. Ensuite, il faut savoir que je vis en Indonésie depuis quatre ans maintenant. Le pays et majoritairement musulman, et beaucoup de mes amis le sont aussi. La religion fait partie de leur vie, mais ils ne cherchent pas à y convertir qui que ce soit, ils gardent ça en eux. Une des choses qui m’a le plus frappé en Indonésie, c’est à quel point les musulmans modérés sont loin de la vision extrémiste de l’Islam représentée dans les médias. Je pense que cette modération est une réalité, et je ne voulais pas représenter l’Islam d’une manière radicale, donc j’ai essayé de faire ça avec subtilité, comme pour dire « vous voyez, le héros est musulman, mais c’est juste une partie de sa vie et de son quotidien ». Je trouvais que c’était important de le dire.
Et donc c’est pour ça que vous ne revenez pas à la question de la religion d’Iko plus tard dans le film ?
Non, ça aurait été mal d’y revenir une fois à l’intérieur du building. Il y a beaucoup de sang, beaucoup de violence, et je ne voulais pas créer de lien entre ça et la religion.
Lorsque vous citez vos influences, vous parlez souvent de Sam Peckinpah, de John Woo et de John Carpenter, mais pas tant que ça de réalisateurs de films d’arts martiaux…
Quand je cite mes influences pour The Raid, je parle surtout de réalisateurs en dehors des films d’arts martiaux parce que, en écrivant, je me suis rendu compte que, si on retire l’action pour ne garder que le concept central, le film fonctionne comme un survival. Je trouvais intéressant le mélanger le film d’arts martiaux avec d’autres genres, d’explorer la tension et le suspense pour aller dans de nouvelles directions. Mais, pour répondre à la question, les réalisateurs de films d’arts martiaux qui m’intéressent le plus sont ceux de l’âge d’or du cinéma d’action hongkongais des années 80 et du début des années 90, dont je suis un gros fan. Les vieux Jackie Chan, Bruce Lee, Jet Li, Sammo Hung ou Yuen Biao, et surtout Fist of Legend, de Gordon Chan, qui est un classique… Chaque fois que j’ai envie de regarder des films d’arts martiaux, je me dirige vers cette époque plutôt que vers les films plus récents, même s’il y en que j’aime beaucoup, comme Ong-Bak, Chocolate, Ip Man ou Flashpoint. Mais dans l’ensemble, je suis plus fasciné par la réalisation et le montage old-school, avec des scènes de combat très claires et détaillées et sans effets superflus. L’important est de mettre en valeur ce qui se passe, de montrer dans l’image la réalité du jeu physique des acteurs, qui est bien plus intéressante que des simples effets spéciaux.
C’est pour ça que vous n’utilisez pas de câbles ?
Oui ! Nous n’avons utilisé des câbles que lorsque la sécurité l’exigeait, ou lorsqu’on voulait réaliser des choses légèrement impossibles. Dans la scène finale, il n’y a que trois moments où nous en avons utilisé. Pour le reste, c’est juste des corps lancés contre des murs.
La suite de The Raid sera votre 4e film consacré au silat. Ca a l’air d’être une obsession chez vous, est-ce que vous imaginez faire un jour un film sur quelque chose d’autre ?
Vous savez, il y a plus de 200 styles de silat différents en Indonésie, et je ne me suis attaqué qu’à 2 ou 3 d’entre eux, alors j’ai encore beaucoup de choses à explorer dans ce domaine. Mais sinon, oui, j’aimerais explorer d’autres genres, je ne veux pas me cantonner aux films d’arts martiaux. Je veux faire du film de gangster, et à un moment donné j’aimerais réaliser un film d’aventures pour enfant, quelque chose que je pourrais regarder avec ma petite fille. Et mon rêve absolu serait de faire un western, ma propre Horde Sauvage, quelque chose que j’aurais pu regarder avec mon père.
The Raid se déroule comme un jeu vidéo beat ‘em up, avec une structure en niveaux et même un boss final… Est-ce que les jeux vidéo étaient une source d’influence, pour vous ?
J’adore les jeux vidéo, mais cette référence ne s’est jamais faite de manière consciente. Certains éléments rappellent effectivement une structure de jeu vidéo, mais je ne m’en suis pas réellement rendu compte jusqu’à ce que le film soit complètement fini. Puisque le film se déroulait dans un building, je trouvais nécessaire d’avoir le « boss » au dernier étage. Si je l’avais mis au rez-de-chaussée, il se serait fait attraper en 5 minutes, et il n’y aurait pas film… Il fallait donc qu’il soit au sommet, et que les personnages doivent avancer progressivement pour l’atteindre, comme dans les jeux vidéo. Je ne supporte pas les films d’action qui usent toutes leurs cartouches pour offrir une toute première scène d’action mémorable et qui n’ont rien d’intéressant à proposer par la suite. Ce que je voulais, c’était que chaque combat soit plus dur que le précédent, que chaque nouveau méchant soit un vrai challenger, un boss de niveau. Donc oui, ça ressemble à un jeu vidéo, mais c’était inévitable pour ce que je voulais faire, et je prends cette comparaison comme un compliment.
D’ailleurs, tout comme dans les jeux vidéo, le joueur (ici, le spectateur) est aussi épuisé que les personnages à la fin. Les scènes de combat sont longues et nombreuses, et elles finissent par épuiser physiquement le spectateur lui-même. C’était volontaire ?
HA ha, je n’y avais jamais pensé ! Pour moi il s’agissait de trouver un compromis entre le fait de garder un ancrage dans une esthétique réaliste et la possibilité d’exagérer la durée des scènes de combat. Je voulais que les scènes aient l’air vrai, que les coups aient l’air réel. C’est pour ça qu’il n’y a pas de scènes acrobatiques ou de triple-coup-pied-sauté : tout ce qu’on voit, ce sont des applications réelles du silat en situation de combat. Ce que je voulais, c’est que les combats se déroulent selon la même logique que si on els voyait se dérouler dans un bar, c’est-à-dire que les mecs ne s’arrêtent pas en plein milieu pour prendre la pause. Du début à la fin, le combat doit être ininterrompu, et personne ne s’arrête tant que son adversaire n’est pas étalé par terre. Du coup, évidemment, ça peut ressembler à un test d’endurance dans lequel le spectateur se retrouve embarqué malgré lui, il faut qu’il se demande « oh mon dieu, mais pendant combien de temps sont-ils capables de se battre ? »
C’est d’ailleurs la principale différence avec les films d’arts martiaux de l’âge d’or hongkongais : dans The Raid, il n’y a pas de morale et pas de code d’honneur.
Oui. Mais tout de même, il y a un certain sens de l’éthique, surtout de la part de Rama et de Jaka, qui refusent tous les deux d’abandonner leur équipe ou de quitter le building tant qu’ils ne sont pas sûrs que tout le monde est en sécurité. Entre les deux frères, il y un lien très fort aussi, puisque Andi choisit de s’opposer à son patron pour faire ce qu’il pense être juste.
D’ailleurs, cette histoire de frères, c’est quelque chose qui semble sortir de nulle part au milieu du film, et qui passe progressivement d’histoire secondaire à histoire principale. En quoi cette relation était importante dans le scénario ?
J’aime les histoires de familles parce qu’elles me touchent et que je peux m’y identifier. Quand j’écrivais Merantau, j’y ai mis beaucoup de choses personnelles, parce que c’est inévitable quand on écrit, on insère les choses qui nous parlent le plus. A un moment, dans Merantau, le personnage d’Iko parle de son frère qui est resté à Sumatra, et grosso modo, cette partie parle de moi, puisque je me suis éloigné de ma famille et de mon frère, avec lequel j’ai grandi et partagé beaucoup de choses, pour venir en Indonésie. Dans The Raid, les éléments personnels viennent aussi de mon expérience de père. Quand on est sur le point de devenir papa, on est préoccupé par beaucoup de choses, on prend conscience de sa propre mortalité, et on se met à avoir peur de ne pas être capable de prendre soin de son enfant jusqu’à ce qu’il puisse se prendre en charge lui-même. Dans The Raid, ce sont des pensées qui s’insinuent dans l’esprit du personnage, qui se demande s’il s’en sortira vivant, s’il pourra être près de sa femme lorsque leur enfant naîtra… Même si ça se fait par petites touches, on amène des morceaux de soi dans les histoires qu’on raconte. Et c’est pour ça qu’on trouve, de manière plus ou moins marquée, des histoires de famille dans The Raid ou dans Merantau.