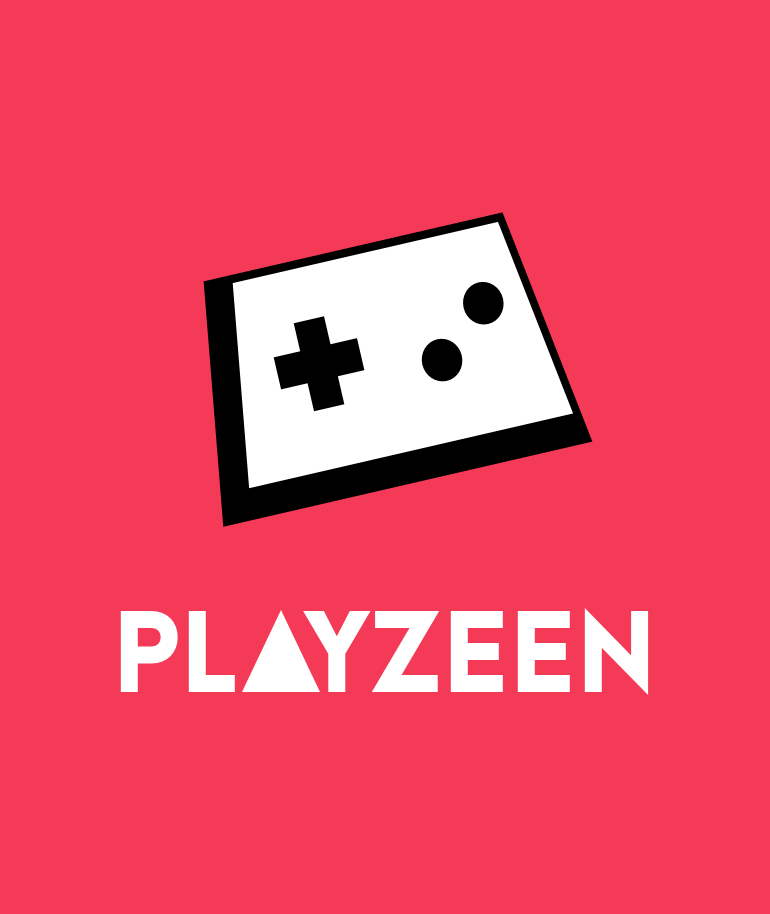[su_note note_color= »#dcdccd »]Rithy Panh s’est fait connaître avec son film Site 2 (1989) distribué par la chaîne franco-allemande Arte, sur un camp de réfugiés en Thaïlande. Ensuite c’est avec S21, la machine de mort Khmère rouge (2002), film documentaire qui constitue un tournant esthétique dans la réalisation documentaire, lorsque l’auteur filme la mémoire des gestes comme témoignage du passé.[/su_note]

Rithy Panh modèle l’argile de son enfance
Avec L’image manquante, son dernier film, le réalisateur franco-cambodgien Rithy Panh utilise des figurines d’argile sur des maquettes en bois et terre cuite pour nous plonger dans son histoire personnelle. Mélangés à des images et des sons d’archive puisés dans le passé de la dictature des Khmers rouges au Cambodge (1975-79), ces plans donnent des allures impressionnistes au long métrage. Le contraste entre les extraits des films de propagande et les séquences des figurines montre que « l’histoire officielle » de l’époque n’était qu’un mensonge, une façade. Cette œuvre a été primée l’année dernière à Cannes dans la catégorie Un certain regard et nominée aux Oscars du meilleur film étranger. Certains commentateurs parlent d’un film « sur la souffrance » et « sur l’absence » mais il me semble que bien au contraire, il s’agit d’un film-trêve. Un film qui porte sur l’affection et sur le besoin d’en conserver des traces, quitte à les enterrer, tout en sachant qu’elles existent quelque part, surtout quand la douleur paraît les avoir effacées. Contrairement à l’idée d’une mémoire comme devoir, le réalisateur semble s’interroger, au fur et à mesure que le film avance, à propos de la mémoire « qu’il lui faut » pour comprendre ce qui s’est passé sous la dictature.
Les premiers gros plans de vagues agitées annoncent le ton donné au film de Rithy Panh : une plongée dans la matière. Le spectateur est embarqué dans un voyage lyrique et onirique où paradoxalement il ne s’agit pas d’images stricto sensu, mais de dialogues à travers cette baignade sensorielle. Randal Douc, le narrateur, nous parle à la première personne et donne voix à l’auteur lui-même. L’auteur nous amène chez lui, dans la maison de son enfance, avec ses parents, son frère et toutes les personnes qu’il a côtoyées pendant ces années terribles de la dictature. Toutes ces personnes prennent corps à travers l’argile. Il les convoque. Leurs gestes, très expressifs, constituent leur vérité. Rithy Panh semble leur parler et nous avons l’impression d’entendre ce qu’ils ont à dire. Les décors nous plongent dans l’atmosphère de ces années-là. Nous accompagnons le réalisateur dans sa visite, dans cette transe à travers la musique hypnotique de Marc Mander. Il nous les présente, nous partageons leur intimité en qualité d’invités plutôt que de voyeurs furtifs. Il vient voir ses invités en argile, il leur parle, leur dit ce qu’il n’a pas pu leur dire à l’époque, dans un geste libérateur et créant un dialogue avec eux, leur rendant leur humanité volée. La mise en scène, intime et empathique, nous invite à rester dans le film.
Dans cette quête, le réalisateur nous amène, en tant que spectateurs, à nous interroger sur la condition humaine. Il nous montre que ces hommes et ces femmes restent des personnes, malgré tout ce qu’ils ont subi. De quelle manière ? En rejouant ces scènes où il prend le temps de nous parler de ses souvenirs d’eux, en imaginant les raisons qui les ont animées, en nous permettant de nous attacher à eux. L’auteur détaille leur découragement, leur peur, leur manque de sommeil, leur fatigue, mais aussi leur résistance quotidienne physique et psychique. Il nous montre de cette façon ce qui les rend singuliers.

Un certain lyrisme se dégage du film malgré la cruauté de certaines scènes. Les figurines prennent vie, animées par la voix du narrateur. Nous les imaginons en mouvement, vivantes. Nous voyons ces personnages résister avec leurs corps et la caméra nous permet de nous en rendre compte et de jouer un rôle actif en tant que spectateurs, elle puise dans notre imagination à travers des plans très rapprochés qui nous font constamment entendre et voir la vie se dérouler au plus près de nous.
Les personnages de L’image manquante sont bien là, nous pouvons les sentir et ressentir leurs émotions voire les toucher à travers l’œil de la caméra, que par ailleurs nous oublions. La caméra devient notre œil ; l’argile le corps vivant, une présence, résistant à un temps de destruction. Ce film est une expérience sensorielle où la vie est présente paradoxalement et malgré le sang. En regardant ce film, nous ne pouvons qu’aller dans le sens du philosophe Theodor Adorno quand il affirma que l’on ne peut pas faire de la poésie après Auschwitz avec de la poésie traditionnelle. L’image manquante apporte une réponse : il n’y a que la poésie comme affirmation de la vie, comme principe contemplatif, qui peut nous rendre l’humanité, notre humanité, après la barbarie. Car dans cette œuvre, il n’est pas question uniquement de la singularité du génocide commis par les Khmers rouges, mais aussi du constat qu’il n’y a que la poésie (dans toutes ses formes) qui reste vraie dans ce qu’elle peut nous révéler et nous apprendre. L’argile semble alors le moyen que le réalisateur a trouvé de rendre la poésie matérielle, autrement dit, de matérialiser la poésie, sa poésie.
[su_note note_color= »#dcdccd »]Dans son choix esthétique S21 peut être comparé au film de fiction, moins connu en France, Chasse aux renards interdite (1966) du réalisateur allemand Peter Schamoni. Dans ce film autobiographique, Ours d’argent en 1966 à la Berlinale, Schamoni raconte des scènes de sa vie familiale (par exemple une scène de chasse avec son père, où ce dernier ne semble épargner aucune souffrance aux animaux), dans lesquelles le passé national-socialiste de la génération des parents semble ressurgir malgré la « volonté » de la société allemande de le cacher. Alors que Schamoni se souvient du naturel avec lequel des gestes cruels réapparaissent dans le quotidien, Panh choisit de son côté de montrer les anciens gardiens du camp S21 refaire les gestes cruels et froids qu’ils faisaient sous la dictature. Dans les deux films, la mémoire des gestes montre que le silence ne suffit pas à faire disparaître une idéologie, mais qu’au contraire, il est indispensable de comprendre comment la montée de la violence a eu lieu et a pu transformer le quotidien. C’est là que L’image manquante montre qu’il est nécessaire de raconter afin de comprendre et tirer des leçons de l’Histoire.
Cf. : Mujica, T. Évocation du “passé” et mise en scène de l’oubli dans le cinéma allemand : Schonzeit für Füchse (Chasse aux renards interdite, 1966), Revue des Sciences Sociales, U de Strasbourg. No. 44, 2010.[/su_note]
Le film est disponible en DVD chez notre partenaire Amazon :